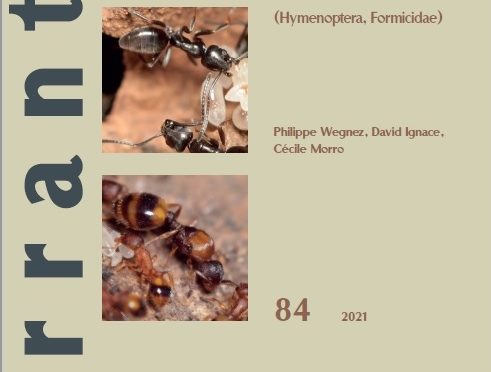Archives de catégorie : Inventaires
Un état des connaissances sur les coccinelles (Coleoptera Coccinellidae) de Montataire
(Département de l’Oise, 60160).
A ce jour, à notre connaissance, seuls trois entomologistes sont passés à Montataire avec l’intention d’observer les insectes et d’y produire – entre autres – des données sur la famille des Coccinellidae. Aux observations réalisées par ces spécialistes, s’ajoutent les observations ponctuelles des élèves des écoles élémentaires Jean Jaurès, Joliot-Curie et Paul Langevin à partir de l’année 2016. Ces observations s’étalent de l’année 2012 à l’année 2021.
Le cumul des observations réalisées fait état de 73 données se rapportant à 23 espèces de coccinelles. La présente note en fournit les détails. Par commodité, les espèces sont présentées par ordre alphabétique du nom scientifique latin. La répartition en sous-famille est donc ignorée. Lorsqu’il existe un nom vernaculaire (en langue française) celui-ci est précisé.
Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) La coccinelle à deux points

Coccinelle moyenne de 4 à 5 mm de long présentant le plus souvent une coloration rouge avec un point noir centré sur chaque élytre, cette coccinelle est recensée à quatre reprises dans la commune. Tout d’abord en août 2012 au parc du prieuré, puis trouvée à nouveau en août 2018 non loin du collège. Enfin, l’espèce a été découverte par des élèves à l’école Paul Langevin en mai 2020 et en février 2021.
Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758) La coccinelle à dix points

Petite coccinelle de 4mm environ dont l’ornementation varie énormément tant en coloration qu’en nombre de points, le phénotype le plus courant comprend une dizaine de points noirs sur un fond plus clair. Cette coccinelle a été trouvée deux fois respectivement en juillet 2019 et en mai 2020, rue du 8 mai 1945
Aphidecta obliterata (Linnaeus, 1758) La coccinelle de l’épicéa ou coccinelle oblitérée

Coccinelle moyenne de 4 à 5mm, dont la coloration brune et plutôt terne s’éloigne beaucoup de l’image populaire de la coccinelle, elle tient ses deux noms français d’une part de la plante sur laquelle, elle est assez fréquemment trouvée et d’autre part d’une caractéristique ornementale : une marque juste derrière la tête ressemblant quelque peu au tampon d’oblitération sur les timbres du courrier postal. Cette coccinelle a été observée deux fois à Montataire : en août 2012 et 2018, respectivement au parc du Prieuré et non loin du collège.
Exochomus quadripustulatus (Linnaeus, 1758) La coccinelle à virgule

Cette coccinelle, dont la taille varie entre 3,5 et 5mm, est très reconnaissable car elle présente coloration noire et brillante ornée de deux taches rouges en forme de virgule. Elle a été découverte à quatre reprises en avril 2017, juillet 2017, août 2018 et mars 2019, d’abord, en bord de rivière non loin de la mairie, puis rue du 8 mai 1945, puis non loin du collège et une nouvelle fois rue du 8 mai 1945. Ces observations sont dues aux trois spécialistes.
Calvia decemguttata (Linnaeus, 1767) La coccinelle à 10 points blancs

Facile à reconnaître, dès lors que l’on prend le temps de compter les dix points blancs qui lui sont caractéristiques, cette coccinelle s’éloigne, elle aussi, largement de l’image d’Epinal que l’on se fait habituellement des coccinelles. A Montataire, il existe actuellement un seul signalement datant de juillet 2013 pour cette grosse coccinelle orangée nuancée de rose de 7mm. Elle a été trouvée sur Aulne dans les boisements attenant au parc du Prieuré.
Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758) La coccinelle des landes

Plutôt petite, avec ses 3 à 5mm, cette coccinelle se reconnaît néanmoins assez aisément sur le terrain à l’aide d’une petite loupe. Il suffit de remarquer son aspect très rond, son dos assez bombé, sa coloration noire brillante et la ligne de points rouge alignés et bien centrée au milieu des élytres. Il existe deux mentions de cette espèce à Montataire. L’une à l’école Joliot-Curie où un individu fût détecté sous le store d’une classe en juillet 2017. La seconde mention vient du stade de l’école Paul Langevin, toujours en juillet 2017. Dans les deux cas, des plantes de la famille des Cupressacées étaient présentes non loin de là.
Coccidula rufa (Herbst, 1783)

Cette petite coccinelle de 2 à 3mm de long, orangée, poilue et au corps allongé apprécie les zones humides et les bords de plan d’eau. Elle a été détectée une seule fois à Montataire en avril 2015 par l’examen attentif de joncs au bord d’un étang du parc du Prieuré.
Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758) La coccinelle à sept points

Cette coccinelle est la seule qui soit réellement connue du grand public. Elle est plutôt grande : entre 6 et 8mm, arbore une coloration rouge orangée aisément identifiable et ponctuée de sept points dont la position ne varie guère. Elle n’a été observée avec une date précise qu’à cinq reprises : en août 2012, en juillet 2013, en janvier et avril 2018, ainsi qu’en avril 2021. Les premières mentions sont au crédit des entomologistes, les trois dernières mentions sont le fait des élèves de Paul Langevin. Néanmoins d’autres observations non datées ont eu lieu sans recherche particulière.
Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758) La grande coccinelle orange

Cette coccinelle se reconnait aisément grâce à sa taille importante : jusqu’à 7,5mm, sa coloration orange bien typique et ses 16 points blancs dont la disposition et la forme ne varient qu’assez peu. Elle a été signalée à trois reprises de Montataire : au parc du Prieuré en août 2012 par, au même endroit en juillet 2013, puis une dernière fois sur un mur d’école, en avril 2018.
Harmonia axyridis (Pallas, 1773) La coccinelle asiatique

Cette coccinelle a été introduite en Europe à des fins d’expérimentation sur la lutte contre les pucerons. Invasive, elle est maintenant présente et commune partout. Assez grande et globalement assez aisée à reconnaître malgré son extrême variabilité pigmentaire, la coccinelle asiatique a beaucoup été observée à Montataire. Entre août 2012 et décembre 2021, ce sont 18 mentions circonstanciées qui ont été produites et cela dans bien des lieux de la commune : parc du Prieuré, rue Louis Blanc, rue Jean Jaurès, en bord du Thérain non loin de la mairie, rue du 8 mai 1945… Tous les stades ont été observés : larve, nymphe et adulte. On peut donc avancer que l’espèce est devenue commune sur le territoire urbain. C’est l’espèce que les élèves détectent le plus facilement.
Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763) La coccinelle à quatre points

Cette coccinelle d’environ 6mm se trouve en examinant attentivement les résineux. Principalement les pins et les épicéas car c’est là que l’animal trouve ses proies favorites. Les trois observations : avril et juillet 2017 ainsi que août 2018 ont été faites de cette manière en bord de rivière non loin de la mairie, rue du 8 mai 1945 et non loin du collège par les trois entomologistes.
Henosepilachna argus (Geoffroy in Fourcroy, 1785) La coccinelle de la bryone

5 signalements ont été précisément datés pour cette grosse coccinelle à la livrée orange mat ornée d’une douzaine de points noirs : deux fois en juillet 2017 rue du 8 mai 1945 et à Magenta puis en mai et juin 2020 ainsi qu’en juin 2021 rue du 8 mai 1945. D’autres mentions non datées ont été faites facilement car la coccinelle est facile à trouver sur sa plante nourricière tant que celle ci n’est pas gyrobroyée. En effet, cette coccinelle est végétarienne et mange exclusivement de la Bryone (Bryonia dioica Jacq, 1774)
Myrrha octodecimguttata (Linnaeus, 1758) La coccinelle des pins ou la coccinelle des cimes.

Inféodée aux résineux et principalement au pin maritime car elle y trouve sa nourriture, la coccinelle des pins n’est néanmoins pas évidente à trouver car elle apprécie essentiellement les hauteurs des arbres. Ce qui lui vaut son deuxième nom vernaculaire de coccinelle des cimes. De taille moyenne entre et le rouge et le brun ornementée de 18 taches blanches fréquemment fusionnées, cette coccinelle ne ressemble en plus pas à l’idée préconçue des coccinelles. Elle n’a été détectée que deux fois dans la commune : d’abord en juillet 2017 puis en mai 2021 par deux élèves sur un mur sous un pin en sortant de leur école.
Nephus quadrimaculatus (Herbst, 1783) La coccinelle « dermeste tortue noire »

On ne peut pas dire que le nom français de cette coccinelle soit informatif et il eut été judicieux de ne pas l’inventer juste pour donner un nom en langue française à une coccinelle qui, jusqu’à il y a peu, n’en avait pas. Discrète avec ses 2mm, noire velue avec 4 petites taches rouges, se cachant fort bien dans les entrelacs de lierre, cette espèce est souvent dure à détecter. Trouvée en juillet 2017 rue Louis Blanc. L’observateur précise avoir trouvé 8 individus : 7 sur lierre et 1 sur érable.
Novius cardinalis (Mulsant, 1850)

Introduite en France, afin de lutte biologique, l’espèce est acclimatée principalement sur le pourtour méditerranéen. Les observations ailleurs en France sont rarissimes. L’unique observation de cette espèce, faite par un élève, dans son jardin de Montataire, en juillet 2021 est donc exceptionnelle. C’est même à notre connaissance la seule observation pour tout le nord de la France, exception faite d’un signalement à Paris intramuros. Néanmoins, l’espèce semble être vendue en jardinerie pour lutter contre certains parasites des arbres et arbustes et peut donc être localement disséminée sans que cela fasse souche. A noter que l’élève concerné, a trouvé le nom de sa découverte en s’aidant certainement d’une application d’identification et le nom trouvé était le bon !
Oenopia conglobata (Linnaeus, 1758) La coccinelle rosée

Cinq signalements seulement pour cette espèce de 4mm de couleur rose ou rouge bordeaux et constellée de points noirs souvent partiellement fusionnés les uns aux autres. Deux fois en août 2012 au parc du Prieuré ; Fin mars 2017, un individu trouvé mort sur un appui de fenêtre de la maison de retraite de Montataire ; un individu trouvé dans une cour d’école en mars 2018 et enfin un individu trouvé en juillet 2020 par un élève profitant de ses congés pour étudier les animaux de son jardin.
Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758) La coccinelle à damier

Moyenne, avec ses 4 à 5mm, cette espèce se reconnait pourtant assez aisément de par les points souvent rectangulaires et en tous cas jamais ronds qu’elle arbore systématiquement. La livrée étant essentiellement blanche à points noirs ou noire à points blancs ressemble beaucoup au drapeau à damier des courses automobiles ou au plateau du jeu d’échecs ou du jeu de dames. Cela lui a valu son nom français. Deux signalements de cette espèce ont été faits à Montataire : en août 2012 et en mai 2020, respectivement au parc du Prieuré et rue du 8 mai 1945.
Psyllobora vigintidupopunctata (Linnaeus, 1758) La coccinelle Marsupilami ou coccinelle à 22 points.

D’un jaune éclatant constellé de 22 points noirs, cette espèce rappelle effectivement le marsupilami créé par Franquin. De taille moyenne avec 4 ou 5mm, son ornementation très atypique pour une coccinelle ne laisse pas indifférent lorsqu’elle est trouvée. C’est arrivé deux fois pour le moment à Montataire : en août 2012 au parc du Prieuré et récemment en septembre 2021 sur un poteau de clôture d’école par quelques-uns des élèves qui prenaient leur récréation.
Rhyzobius chrysomeloïdes (Herbst, 1792) La rhyzobie des arbres

Cette coccinelle de taille assez moyenne se trouve quasi exclusivement au battage des branches des arbres et arbustes. De teinte essentiellement terne, elle est donc discrète et passe assez inaperçue. Un dessin plus ou moins marqué en forme d’ancre de bateau ornemente régulièrement ses élytres. Elle a été trouvée à deux reprises en avril 2017 au bord du Thérain puis en juin 2020 rue du 8 mai 1945.
Rhyzobius forestieri (Mulsant, 1853)

Cette petite coccinelle de 3 à 4mm très ronde aux ailes noires et au ventre rouge est une espèce introduite en Europe. Depuis, elle s’y acclimate et prospère dans la discrétion. Une soixantaine de mentions existe en France selon la cartographie du Muséum Nationale d’Histoire Naturelle. Cela ne reflète sans doute pas la réalité de sa présence. Une mention existe pour Montataire : en août 2018, deux des entomologistes ont trouvé l’espèce non loin du collège.
Scymnus interruptus (Goeze, 1777) La coccinelle velue à bandes

Minuscule coccinelle n’atteignant pas les 2mm de long, elle est noire, couverte d’un fin duvet de poils, présente le plus souvent des taches triangulaires rouge-orangé touchant le bord des ailes. Elle a été trouvée à trois reprises en février, avril et juillet 2017: rue du 8 mai 1945, en bord du Thérain non loin de la mairie et rue Louis Blanc. Sa découverte reste affaire de spécialiste : c’est la technique du battage qui fut utilisée sur noisetier, érable, aulne et frêne.
Sospita vigintiguttata (Linnaeus, 1758) La coccinelle de l’Aulne

Assez grande, cette espèce présente deux colorations bien typiques : elle peut être rose à vingt points blancs ou noire à vingt points jaunes. Comme son nom français l’indique clairement, cette espèce est très liée à un arbre poussant préférentiellement dans les zones humides telles que les marais et les bords de cours d’eau. C’est au parc du Prieuré qu’un entomologiste l’a trouvé au début du mois d’août 2012, c’était alors une première mention départementale. Aucune autre mention depuis dans la commune pour cette coccinelle indiquée rare et très discrète. A ce jour, seules dix autres communes du département ont renseignées pour cette espèce. Elle reste donc toujours une vraie rareté entomologique.
Vibidia duodecimguttata (Poda, 1761) La petite coccinelle orange

Effectivement orangée et tachées de 12 points blancs, cette petite coccinelle ne dépasse pas les 4mm de long. Elle a été trouvée deux fois au parc du Prieuré en août 2012 et une fois rue du 8 mai 1945 par les entomologistes déjà cités. On peut indiquer une particularité alimentaire pour cette espèce : elle consomme des films mycéliens sur les feuilles des végétaux qu’elle fréquente. Dit plus simplement : elle mange des champignons. C’est le cas de plusieurs autres espèces de coccinelles.
Avec 23 espèces recensées dans Montataire, la ville se classe parmi les communes les mieux renseignées du département de l’Oise. Cette diversité d’espèces illustre les nombreux milieux qui émaillent le territoire communal. Avec seulement 73 observations circonstanciées, la somme de données sur la famille des coccinelles reste faible. Les observateurs ont en quelque sorte privilégié l’efficacité plutôt que la quantité. Il en ressort une petite impression de manque. Une recherche plus systématique et plus poussée conduirait certainement à une augmentation significative de la diversité des coccinelles. Si un pronostic devait être fait, attendu la grande diversité de milieux tant urbains que ruraux, allant du chaud sec au froid humide, il serait d’un minimum de 35 à 40 espèces présentes sur le territoire. Il ne reste plus qu’à les trouver !
Remerciements :
Tout d’abord aux nombreux élèves des écoles Paul Langevin, Joliot-Curie et Jean Jaurès depuis septembre 2016. Leur curiosité, leur envie de découvrir leur environnement et d’apprendre de nouvelles choses sont à l’origine de cette synthèse entomologique. Leurs observations ponctuelles ont de plus significativement amélioré cet inventaire. Bravo à eux. A mes complices entomologistes de longue date : Mme D. et M. T. Toujours aussi efficaces.
L’escapade des abeilles
ENQUÊTE « PARTICIP’ACTIVE » !
contact Carole Derozier :
secretariat@adepentomo.fr
L’ADEP initie un projet de cartographie
des nidifications de l’abeille mellifère
(Apis mellifera) à l’état sauvage
et donc hors ruche
exploitée par l’apiculture.
Ce projet sera étendu à l’échelle des Hauts-de-France.
Deux types de nidifications
sont concernés :
► Les nidifications
internes :
Ce sont des nids situés dans des espaces relativement clos, par exemple dans des cavités d’arbres, conduits de cheminée, poteaux creux, habitats humains. Ces nids sont majoritairement peu visibles mais se repèrent par l’activité des abeilles.
Des jumelles peuvent être utiles pour les observer, même si ces nids peuvent se situer à des hauteurs très variables. Exemples, in natura :



Exemple sur bâtiment :

► Les nidifications
externes :
Ce sont des nids pour lesquels les rayons sont construits à l’air libre, faute de cavités propices, le plus souvent sur les arbres, conifères comme feuillus. Ce type de nidification est voué à l’échec car la colonie ne résistera pas au froid de l’hiver. Ces nids se repèrent à partir de mai et jusqu’en hiver, saison durant laquelle l’ouvrage des abeilles se délitera avec les intempéries.
Exemples in natura :


Exemple sur bâtiment :

Pour mener à bien un tel projet nous recueillons directement vos observations et vos photos, avec leur localisation et date si possible.
Merci pour vos contributions !
(secretariat@adepentomo.fr)

ABC Noailles : Rapport ADEP
Nous vous invitons à lire le rapport de l’ADEP concernant l’Atlas de la biodiversité communale (ABC) de la ville de Noailles. Cette étude a ciblé trois groupes d’arthropodes connus pour leurs richesses en espèces : fourmis, abeilles sauvages et araignées. Les inventaires ont été conduits en 2021.
Bonne lecture !
Coléoptères saproxyliques : Le projet SAPROX
Dans le cadre de l’animation de l’inventaire national des coléoptères saproxyliques un webinaire est organisé et se tiendra le
samedi 20 novembre 2021.
Ce séminaire en ligne sera l’occasion de faire le point sur le projet SAPROX, ses perspectives et d’apporter des éclairages sur les coléoptères saproxyliques. Le programme détaillé est disponible en ligne.
Pour en savoir plus et s’y inscrire, retrouvez le lien vers la page du Site SAPROX ici :
Arthropodes & infrastructures agroécologiques en agriculture biologique, Ferme du développement durable, Herleville, Hauts-de-France.
M. Proot G., exploitant agricole, a fait appel en octobre 2019 à l’Association des Entomologistes de Picardie pour obtenir des éléments de valorisation de leurs actions menées en agriculture biologique, en particulier en faveur de la biodiversité. L’ ADEP a proposé la réalisation d’un état des lieux de la connaissance de neuf groupes d’arthropodes dans les infrastructures agroécologiques (I.A.E.) : haies, bandes enherbées et prairies temporaires, l’intérieur des parcelles de cultures n’étant pas concerné.

Télécharger le poster pour consulter les résultats. Rapport d’étude complet disponible sur demande au secrétariat.
Atlas de fourmis du Luxembourg
Pour les passionnés des fourmis, nous vous proposons de retrouver l’intégralité de l’atlas des fourmis du Luxembourg dirigé par notre collègue Philippe WEGNEZ.
Cet atlas myrmécologique est le résultat d’une recherche
quinquennale (2013–2017) menée sur l’ensemble du
territoire du Grand-Duché du Luxembourg et ciblant
tous les types de milieux possibles afin d’obtenir la
meilleure représentativité de la faune luxembourgeoise
des fourmis, avec leurs spécificités et exigences écologiques.
Une liste globale reprend les 66 espèces qui ont
été trouvées au Luxembourg depuis plus d’un siècle
avec une indication sur leur statut de conservation, des découvertes et une clé d’identification.
Observer les insectes
DISCOURS DE LA MÉTHODE
Ou comment l’on chasse et pourchasse les insectes et autres arthropodes pour les observer ou inventorier
Il existe toutes sortes de méthodes, utilisées par les entomologistes et naturalistes pour provoquer l’occasion de rencontrer leurs chères bestioles ; des procédés les plus aléatoires et hasardeux, du déploiement de moyens actifs, voire hyperactifs aux méthodes plus passives, voire passoires. Nous allons tenter ici d’en dresser un petit inventaire, non exhaustif, à destination des débutants et de tous les curieux de nature.
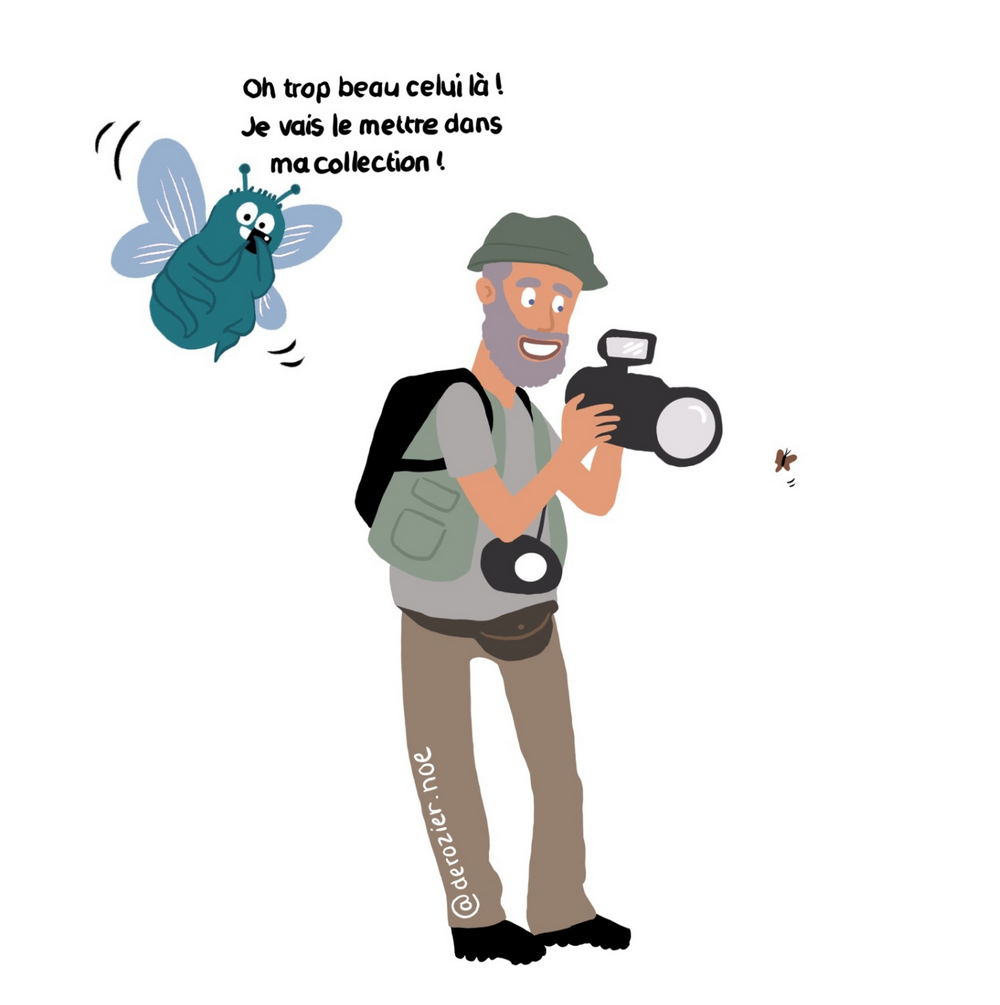
► LA RECHERCHE « À VUE » DE NUIT, avec une lampe torche ou une lampe frontale ; cette méthode combine l’attraction lumineuse au plaisir de la balade nocturne. De nombreux insectes, attirés par la lumière viennent volontiers se faire observer. Ah… les feux de la rampe !
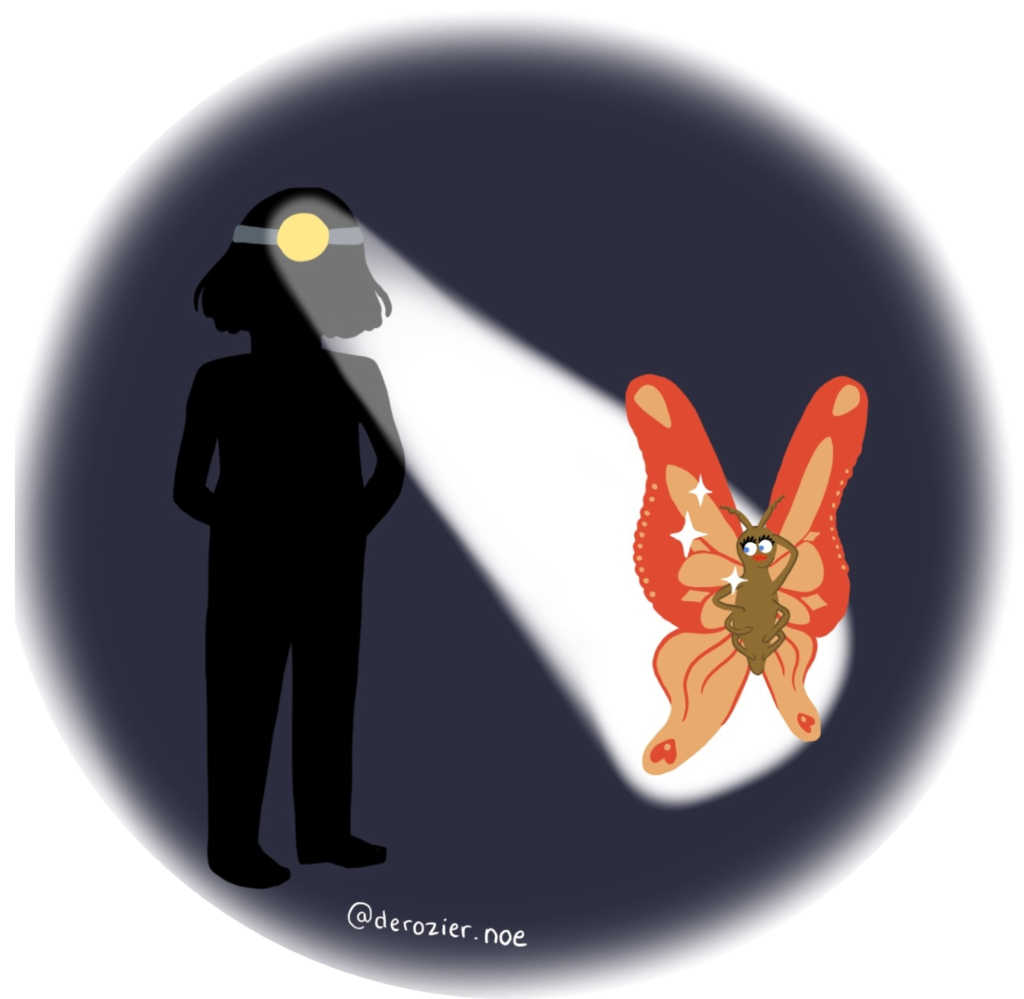
► LES FOUILLES PLUS POUSSÉES SUR LE TERRAIN : quand à la mauvaise saison ne volent plus que des feuilles mortes, on peut patienter en attendant le retour des beaux jours en débusquant les petites bêtes jusque dans leur refuge hivernal ; dans les souches, sous les écorces des arbres, dans les grottes et cavités et toutes sortes de cachettes (jusque dans les maisons).

► LE FILET À PAPILLONS qui peut attraper au vol les papillons bien sûr, mais aussi de multiples familles d’insectes volants. Un « filet de voiture » a même été inventé : fixé sur une voiture, ce grand filet permet de capturer les insectes se déplaçant sur le trajet de la voiture. On peut bien sûr l’utiliser de nuit, l’éclairage des phares de la voiture attirant d’autant plus.

► LE FILET TROUBLEAU pour aller chercher les petites bêtes vivant au fond de l’eau ; ce petit filet, fixé au bout d’un manche solide, sera enfoncé dans les herbiers aquatiques et la vase dans lesquels vivent des coléoptères, punaises, larves de libellules, etc.
► LE FILET-FAUCHOIR, plus solide que le filet à papillons, il permet de ratisser les herbes basses en faisant un mouvement de va-et-vient pour y collecter les petites bêtes qui s’y trouvent.

► LA MÉTHODE DU BATTAGE utilise le parapluie japonais, encore appelé nappe de chasse ; cet objet présente une toile plane sur une armature légère que l’on tient horizontalement sous les branches des arbres que l’on va battre pour en faire tomber chenilles, araignées, punaises et toutes sortes de petites bêtes qui se croyaient bien tranquilles.
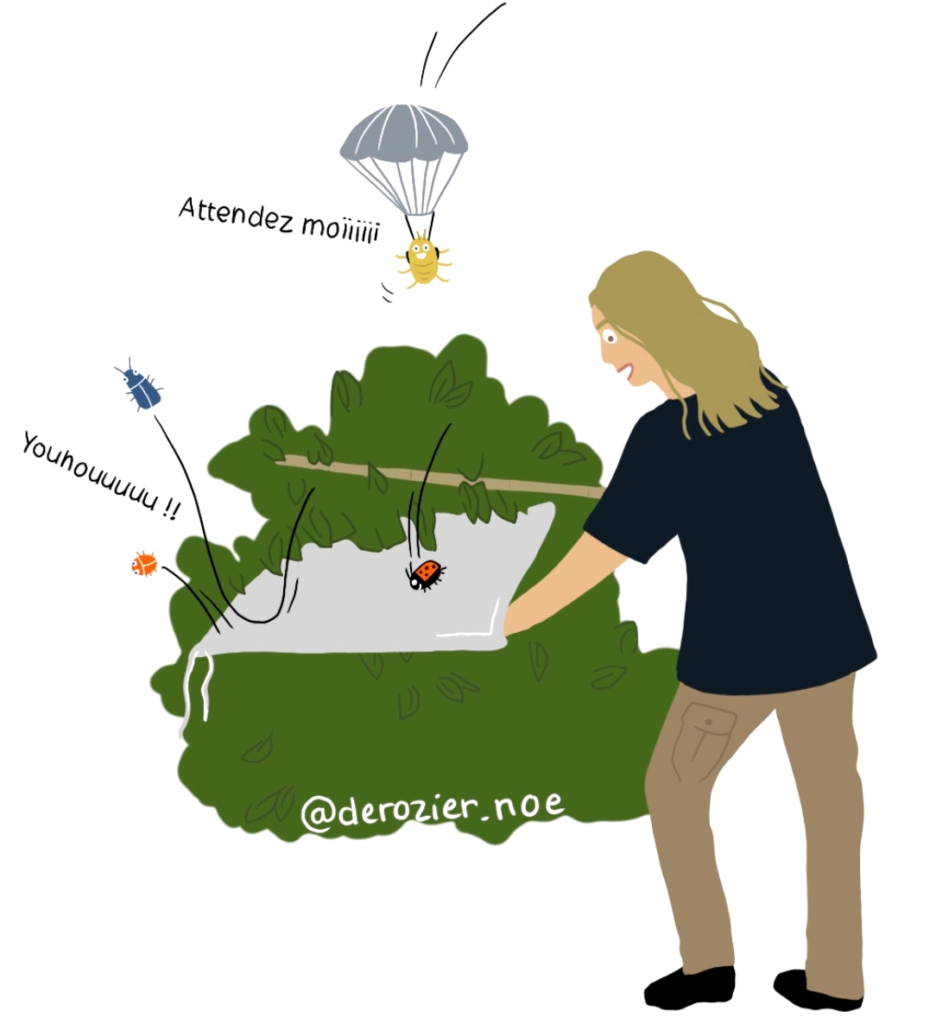
► LES TAMIS ; dispositifs permettant par exemple de filtrer la litière et de la séparer des multiples petits arthropodes cachés dedans. Indispensables pour l’étude des fourmis, par exemple. Certains tamis sont fixés au fond d’un filet-fauchoir pour que les bêtes capturées ne se sauvent pas illico.
► L’ÉLEVAGE (c’est-à-dire le nourrissage de chenilles et autres larves, ou la mise en caisse de bûches contenant des larves de coléoptères xylophages, par exemple) ; vous avez la fibre maternelle ? Alors adoptez une chenille, une larve de coléoptère, de punaise ou autre. Fournissez-lui les conditions nécessaires à sa jeune vie et attendez patiemment la fin des métamorphoses : vous pourrez alors découvrir qui se cachait derrière la jolie petite larve !
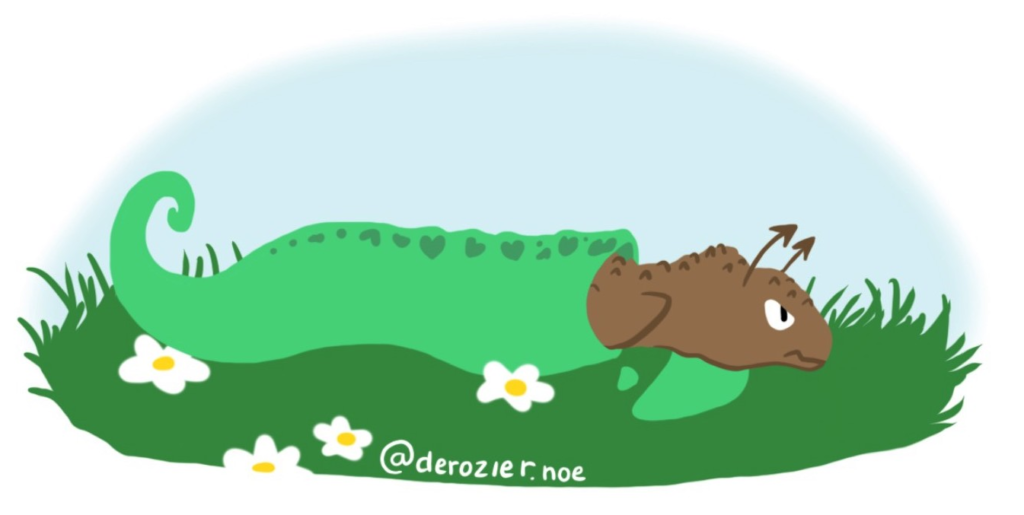
► LA MÉTHODE DITE DE « LA MIELLÉE » ; il s’agit de concurrencer les sources nectarifères par une gourmandise savamment préparée et étalée pour y attirer les insectes, de jour comme de nuit. Chacun y va de sa recette, mêlant bière, confitures, jus de fruits, sucres, fruits avancés, vin rouge, miel et autres mixtures… mais chut ! La recette reste secrète, chacun la sienne ! Cette mixture sucrée peut être introduite dans une bouteille trouée et suspendue dont les insectes ne pourront ressortir. Il est également possible d’attirer certains coléoptères avec… de la truffe, m’sieurs dames, rien que ça !Ou les fourmis avec des rillettes de poisson ! Moins gourmande, mais particulièrement attirante pour les insectes nécrophages (= mangeurs de cadavres) : la pose d’un cadavre de petite bête en voie de décomposition pourra permettre d’observer les indispensables insectes nettoyeurs qui profitent de cette source de nourriture, dans laquelle ils peuvent également pondre leurs larves.

– LE PIÉGEAGE PAR ATTRACTION LUMINEUSE (piège lumineux sur dispositif vertical, horizontal, pyramidal, cubique, etc.) ; autant d’entomologistes, autant de dispositifs ! Le principe restant de dérouter et détourner les insectes se déplaçant incognito la nuit en les attirant par une lumière spéciale (lampe led ou à UV) qui les incite irrésistiblement à se poser sur la surface réfléchissant la lumière (souvent un drap ou un mur blanc).
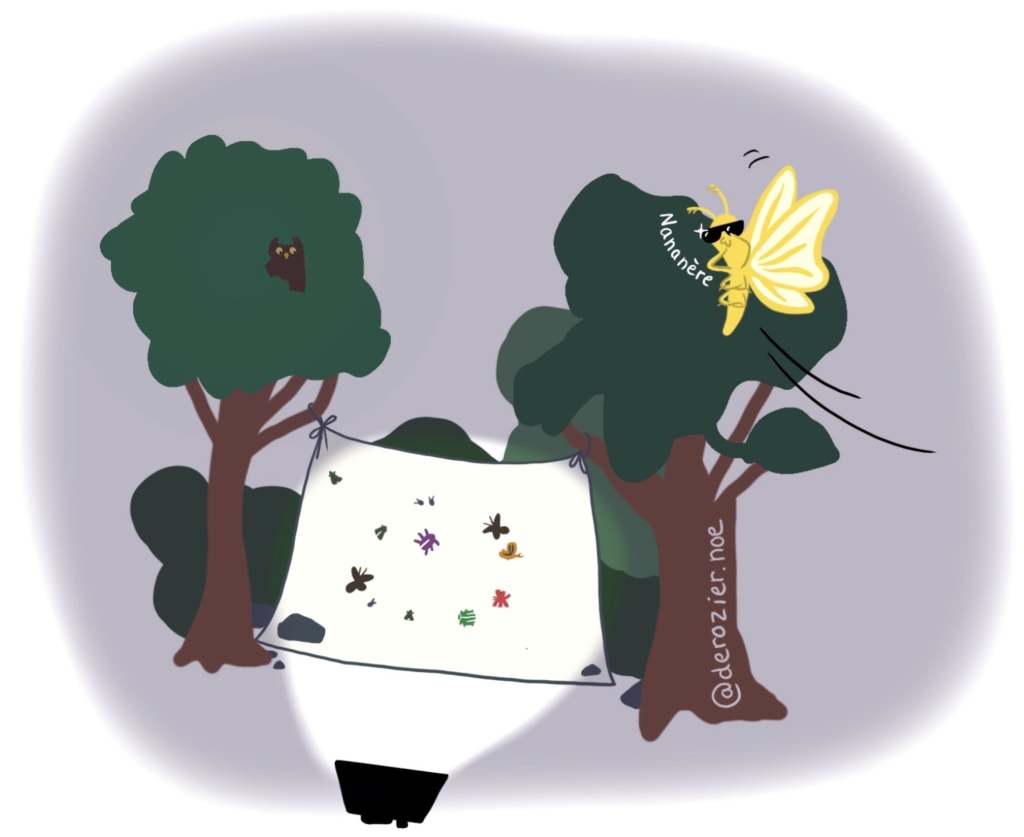
► LE PIÉGEAGE PAR PHÉROMONE ; cette méthode permet de sélectionner d’avance l’espèce que l’on cherche à attirer au moyen d’une phéromone qui lui est propre. L’idée est de disposer un petit tube imprégné d’une imitation chimique de l’odeur émise par la femelle pour attirer les mâles et se reproduire (phéromone). Cette phéromone est mise dans une boîte dans laquelle le mâle va rentrer sans pouvoir en ressortir. On peut aussi utiliser une femelle vierge (c’est-à-dire venant d’éclore) pour attirer des mâles. Cette méthode fut notamment utilisée par Jean-Henri Fabre.

– LES PIÈGES AU SOL : ce sont des pièges en forme de gobelet, que l’on enterre au ras du sol, et qui contiennent soit un mélange attractif soit un mélange d’eau saturée de sel et d’un peu de liquide vaisselle permettant de conserver les bêtes qui coulent au fond. Cette méthode permet d’échantillonner les petites bêtes qui se déplacent au sol dans le secteur du piège. Il faut régulièrement venir récolter les insectes et araignées tombés dans le piège.

► LA MÉTHODE DU PIÉGEAGE PAR COULEURS, dans le même registre, consiste à disposer au sol des récipients vivement colorés (jaune, bleu ou blanc) en fonction des familles d’insectes que l’on cherche à attirer. Un peu de liquide (eau salée pour la conservation + quelques gouttes de liquide vaisselle pour éviter que les insectes flottent à la surface du récipient) permettra de conserver les bêtes jusqu’au retour de l’observateur. Les rubans « tue-mouche » de nos grands-mères utilisaient cette attraction par la couleur, en piégeant non plus avec un liquide, mais avec une glu.

► LES PIÈGES À INTERCEPTION : il s’agit de dispositifs la plupart du temps verticaux et invisibles (voilage, plastique transparent), situés sur la trajectoire des insectes, qui s’y engouffrent et sont ensuite capturés dans un réceptacle. Ce principe peut être décliné de multiples manières selon les matériaux et récipients utilisés. C’est le principe utilisé par la tente malaise, par exemple.
Etc. ! La plupart des objets décrits peuvent être bricolés par l’amateur et perfectionnés selon ses besoins et expériences, et même combinés entre eux. Par contre, les enfants veilleront à se faire accompagner d’adultes expérimentés, car les rencontres avec les bestioles ne sont pas toujours simples à gérer (frelons, guêpes, chenilles de processionnaires… sans parler des vilaines tiques).

Pour une bonne pratique, respectueuse des espèces sensibles, l’amateur commencera par les techniques les plus douces, sans prélèvement, afin de perfectionner ses connaissances et de ne pas tuer inutilement les insectes dont chacun a désormais conscience que s’il est utile de les inventorier et de les mieux connaître pour les préserver, il faut également veiller activement à leur conservation et à celle de leurs milieux de vie : ils sont notre bien commun !
On l’a vu, les méthodes sont multiples, mais quelles que soient celles utilisées, le plus efficace est de les varier en fonction de la saison, du matériel à disposition, des milieux prospectés, des bêtes recherchées.
Avec une unique motivation : le plaisir de la découverte !
ABC Noailles
CAP SUR NOAILLES ! (2)
Oh, punaise !
L’entomologiste qui fait un inventaire rêve bien entendu de rencontrer un grand nombre d’espèces d’insectes communs, mais espère surtout observer des petites bêtes un peu inédites pour lui et donc peu communes.
Ce fut le cas le dimanche 18 avril, lors de mes premières observations dans le cadre de l’ABC (Atlas de la Biodiversité Communale) organisé sur la commune de Noailles, où la visite d’un petit coteau m’a permis entre autres l’observation de quelques hémiptères :
► Haematoloma dorsata (Ahrens, 1812) :

Deux exemplaires de ce joli Cercope furent obtenus au fauchage des herbes basses, non loin de petits résineux. Le Cercope fait partie de l’ordre des Hémiptères, comme les Punaises, Cigales, Pucerons ou Cochenilles. Il appartient à la famille des Homoptères. Il pond ses œufs à la base des tiges de graminées ou sur le sol pour cette espèce précise, ses larves s’enduisent ensuite pour se protéger d’une mousse blanche appelée « crachat de coucou » ; tout promeneur un peu attentif en a déjà remarqué. Ce Cercope particulier, dont la base des ailes est ourlée de rouge, se distingue ainsi facilement des deux autres espèces de Cercope, plus communes : Cercopis vulnerata Rossi, 1807, le Cercope sanguin, qui possède trois paires de taches rouges sur les élytres, dont un joli W vers le bas des ailes :

et Cercopis intermedia Kirschbaum, 1868, le Cercope intermédiaire, reconnaissable à ses genoux rouges :

► Peritrechus gracilicornis Puton, 1877

Une petite punaise Lygaeidae (moins de 5 mm !), dans la famille des Ryparochromidae ; difficile à distinguer des autres espèces de Peritrechus, il faut ici regarder de très près la répartition des couleurs sur le pronotum et les élytres, l’épaisseur du 3ème segment antennaire, les petites épines et la grande sur le tibia avant, la couleur des tibias arrière… Un genre compliqué à identifier ! Cette petite punaise affectionne les milieux secs.
► Gonocerus juniperi, Herrich-Schäffer, 1839,
le Gonocère du genévrier :

Cette punaise au corps allongé appartient à la famille des Coreidae, au genre Gonocerus ; rouge et verte sur le dessus, elle est d’un vert presque jaune au-dessous. Relativement commune lorsque sa plante préférée est présente, il était logique de la trouver au battage de genévrier. Mais on peut également la rencontrer sur thuya.
► Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794)
la Punaise des genêts :

Trouvée au fauchage des herbes basses, non loin de pieds de genêts, sa plante préférée, cette jolie punaise de la famille des Pentatomidae peut revêtir des couleurs très variées, allant du vert jaune au brun doré, avec des touches de rouge, en fonction de sa maturité sexuelle et de la saison, mais toujours d’aspect brillant. Ses antennes sont orangées et le bord de son abdomen est de couleur vert jaune. Assez commune, il est cependant toujours plaisant de la rencontrer ; elle aime également les milieux secs.
► Taphropeltus contractus (Herrich-Schäffer, 1835) :

Moins de 4 mm pour cette petite punaise appartenant aux Lygaeidae ; la tête se resserre derrière les yeux, qui sont proéminents, elle a de longs poils sur les fémurs avant. Elle affectionne les habitats secs. Celle-ci fut trouvée au tamisage de litière ; merci à Laurent notre myrmécologue de m’avoir permis de picorer dans son tamis !
► Osphya bipunctata (Fabricius, 1775) :
Enfin, pour changer des Hémiptères, un joli et peu commun coléoptère, qui appartient à une petite famille peu connue, les Melandryidae.

Longiligne, de coloration variable selon le sexe, le pronotum est bordé de jaune presque translucide, les 2 premiers articles des antennes sont jaunes ainsi que le haut des pattes. Ce coléoptèrevraiment peu commun est surnommé le faux Cantharide ; en effet, il trompe son monde en ressemblant à un Cantharidae, mais il n’a pas leurré Jean-Claude Bocquillon, coléoptériste de l’ADEP, qui m’a aidée à l’identifier, merci à lui.
Cap sur Noailles !
Les premières sorties ont eu lieu ce WE pour un inventaire faunistique sur la commune de Noailles (Oise).
Bien entendu, les arthropodes sont au « menu » de l’étude menée par l’ADEP. Cet inventaire est l’occasion de mettre à jour la biodiversité à l’échelle communale.
Voici les premières photos en avant première !
Nous remercions chaleureusement Valentin pour son accompagnement sur le terrain.

Ci-dessus : la « dream team » tout sourire du dimanche 18/04 : Ludivine, Adrien et Carole. Samedi 17/04 déjà, Alexis et Julie accompagnés de Valentin et d’Adrien avaient déjà investi les lieux.

Différentes techniques sont utilisées pour découvrir le monde des insectes et araignées. Ici le filet entomologique.

Un syrphe (ici, une femelle Xanthogramma citrofasciatum) : souvent confondu et pris pour une guêpe, il s’agit en fait d’une mouche pollinisatrice, indispensable à nos écosystèmes.


Les premières découvertes. Ci-dessus : la minuscule fourmi « fugace » Solenopsis fugax (2 mm). Ci-dessous, une belle Hespérie se chauffant au soleil.


Le second site : un reliquat d’ourlet calcicole. Ces milieux sont essentiels pour y trouver des espèces d’intérêt patrimonial.
Ci-dessous Valentin nous rejoint et Laurent utilise un tamis portable (une autre technique pour révéler la pédofaune).


Une journée bien agréable et ensoleillée qui s’achève sous l’œil vigilant d’une élégante fauvette grisette.
Petit suivi entomologique de la pelouse calcicole de Bellevue (Oise 60).
Par Alexis BLIOT.
Découvrez ce « larris » exceptionnel au pied de la Forêt de Compiègne.
Abeilles sauvages : Bilan des connaissances & actions de l’ADEP, 2010-2020
Cette note tente de restituer les connaissances acquises en Picardie sur les abeilles sauvages au cours d’une décennie. Les prospections entomologiques ont ciblé des espaces ruraux, des espaces dit naturels et des marges d’agglomérations. La pression d’observation est restée modeste avec une couverture disparate du territoire picard. Les résultats sont exposés en fonction d’une catégorie simplifiée de milieux et en fonction d’un découpage géographique flou. Au-delà d’une classique contribution à la connaissance d’un groupe d’insectes, j’ai souhaité valoriser au mieux les spécimens récoltés, le travail du naturaliste ainsi que l’implication de l’association. Cette note coïncide avec l’achèvement du Plan National d’Actions en faveur des pollinisateurs sauvages. La curiosité du vivant, le plaisir d’herboriser, la chaleur et la lumière des belles saisons sont restés les facteurs déterminants de motivation.
Version haute définition sur simple demande auprès du secrétariat.

Abeilles sauvages en Thiérache : recueil de connaissances (2014-2020)
Ce document sur les abeilles sauvages a pour objectif de valoriser les observations recueillies au cours de rencontres collaboratives entre l’ADEP et le CPIE de l’Aisne et en y ajoutant des données personnelles et partagées de Guénael Hallart.
L’objectif étant d’améliorer nos connaissances des arthropodes notamment dans le Nord de l’Aisne.

Bombus sylvarum (Linnaeus, 1760) : Article de presse

Diversité des abeilles sauvages, Parc naturel régional, Oise – Pays de France.
Le Parc naturel régional Oise – Pays de France en partenariat avec l’ADEP ont contribué au Plan National d’Action (PNA) France, terre de pollinisateurs pour la préservation des abeilles et des insectes pollinisateurs sauvages en mettant en œuvre différentes actions :
– Réalisation d’inventaires des abeilles sauvages dans des espaces verts communaux, des sites sportifs et dans des sites naturels,
– Organisation de formations, conférences, visites pour différents publics (élus et agents communaux, correspondants Parc, habitants…),
– Élaboration de fiches techniques, – Production d’outils de communication (plaquette, brochure…).