Photos et textes : L. Colindre – 04-05/2018
Nichés en plein cœur de l’Amérique centrale, les deux pays frontaliers n’ont rien à s’envier : une chaîne volcanique commune, une forêt tropicale humide et sèche, deux côtes océaniques, une situation géographique d’intérêt, etc. J’y rajoute également une beauté des paysages à couper le souffle.
Nous pourrions donc en déduire que la biodiversité devrait être similaire. Pourtant, si le Costa-Rica fait l’objet de nombreux projets de recherches scientifiques et technologiques, il en n’est pas de même pour le Nicaragua.
Concernant les fourmis, la base AntWeb arrêtée au 07/05/2018 (https://www.antweb.org/) identifie pour le Costa Rica, 107 genres, 1032 espèces (dont 117 endémiques et 16 introduites) contre 91 genres, 464 espèces (dont 6 endémiques et 9 introduites) au Nicaragua. Le différentiel est d’importance, qui plus est, quand on sait que la superficie de ce dernier pays est 2.5 fois supérieure au Costa-Rica.
L’ouverture récente du Nicaragua permettra sans doute d’y révéler une biodiversité tout au moins identique à son voisin. Espérons que les derniers évènements politico-sociaux ne viennent pas gâcher les efforts réalisés en ce sens…
 Ecrin de verdure. Costa-Rica ; forêt tropicale humide.
Ecrin de verdure. Costa-Rica ; forêt tropicale humide.
Nicaragua : lac du cratère (volcan Apoyo) et volcan Mombacho en arrière plan. Forêt tropicale sèche.
Hyménoptères / Formicidae :
Les fourmis « légionnaires » ou fourmis « nomades » se déplacent en colonnes rangées impressionnantes de plusieurs mètres de long (constituées de 100 000 à 750 000 individus, Passera 2008). Elles dévorent (et par conséquent nettoyent) tout ce qui passe sur leur chemin. Elles ne laissent pas indifférent quand on croise leur chemin. Leur piqure est douloureuse (je l’ai testé pour vous !). Si on peut comparer l’intensité de la piqure à celle d’une guêpe, la différence est nette dans sa durée. Plus de 5 à 7 minutes après, la douleur est encore vive puis s’estompe sans autre conséquence.
Fourmi légionnaire du genre « Eciton ». Ici un soldat aux mandibules démesurées (que les Indiens d’Amérique du Sud utilisent pour suturer les plaies en se faisant mordre puis en arrachant le corps et laissant la tête !). Sur la photo on peut distinguer une ouvrière « media » juste en-dessous. Le polymorphisme est particulièrement important chez ces espèces avec plus de 4 castes décrites.
Les espèces de fourmis dites « champignonnistes » (« Zompopa ») appartiennent principalement aux genres Atta et Acromyrmex (Formicidae/Myrmicinae).
Ne digérant pas la cellulose, les fourmis cultivent un champignon qui fait le travail pour leur compte. Pour le cultiver, elles collectent des morceaux de feuilles puis les transportent dans la fourmilière (cf. photo ci-dessous), un nid de structure complexe et souvent très grand. L’impact sur la végétation alentour est considérable (8775 kg / hectar /an pour un nid important d’Atta en Amérique du Sud, Passera 2008). Néanmoins elles assurent également par ce moyen, l’aération et la régénération des sols souvent pauvres. Les ouvrières « minors » se chargent de réduire les feuilles afin que le champignon puisse s’y développer. Cette cellulose apporte alors le sucre dont le couvain des fourmis à besoin.
En échange, elles assurent au champignon une protection contre d’autres champignons pathogènes (les fourmis possédant des glandes antibactériennes), facilitent son implantation dans la litière du nid et assurent sa dissémination lors des essaimages.
Il existe trois castes d’ouvrières (et probablement des « sous-castes ») : les ouvrières minors (2-4 mm) qui s’occupent du couvain ainsi que du nettoyage du nid. Les ouvrières médias (5-10mm) qui récoltent et les ouvrières majors ou soldats (>10mm), protégeant la fourmilière dès qu’il y a danger. Il suffit de taper du pied proche de l’entrée du nid pour que les ouvrières majors en sortent instantanément. Elles sont facilement reconnaissables à leur large tête et à leurs fortes mandibules. Une amie qui a voulue manipuler un soldat l’a su très rapidement avec une coupure sur un doigt (merci Christelle pour cette expérience !!). Elles sont en outre quasiment les seules à tenir tête aux fourmis légionnaires…
Ouvrière major du genre Atta ou Acromyrmex.
La fourmi « balle de fusil » (Paraponera clavata, ci-dessous), est une très grosse ponéromorphe. Gare aux étourdis qui mettraient la main dessus ! (d’où le patronyme comparant la douleur à une balle reçue). Une piqûre peut tuer une souris (Passera 2007).
Entrée du nid de Paraponera clavata
Quelques autres arthropodes rencontrés :
Coléoptères :
D’autres Hyménoptères :
Quelques guêpes et abeilles…
Guêpe sp
Cette abeille de quelques millimètres, inoffensive du Nicaragua (appelée « Mariola ») est élevée pour son miel. Le nectar n’a bien sûr absolument pas le même goût que celui de nos abeilles (elles butinent sur les fleurs d’avocat). En outre, son miel est très liquide et la production ne dépasse pas le litre par ruche !
Ruche et nid
Isoptères :
Nids de termites omniprésents en forêt tropicale humide et sèche et quelques individus !
Lépidoptères :
En haut : papillon du genre Morpho et dessous le « Hibou » (Caligo eurilochus).
Orthoptères :
Sauterelle « feuille » (Nicaragua).
Criquet sp (Costa-Rica)
Arachnides :
En dehors des insectes, notons la présence de cette belle Arachnide :
Mygale sp (=Tarentule pour les anglophone). Nicaragua
Parce que ces deux pays ne sont pas qu’un « réservoir » d’insectes, je ne résiste pas à l’idée de vous montrer quelques représentants emblématiques :
Paresseux à trois doigts (Bradypus tridactylus).
Toucan à carène (Ramphastos sulfuratus)
Singe capucin avec son jeune (Cebus capucinus)






























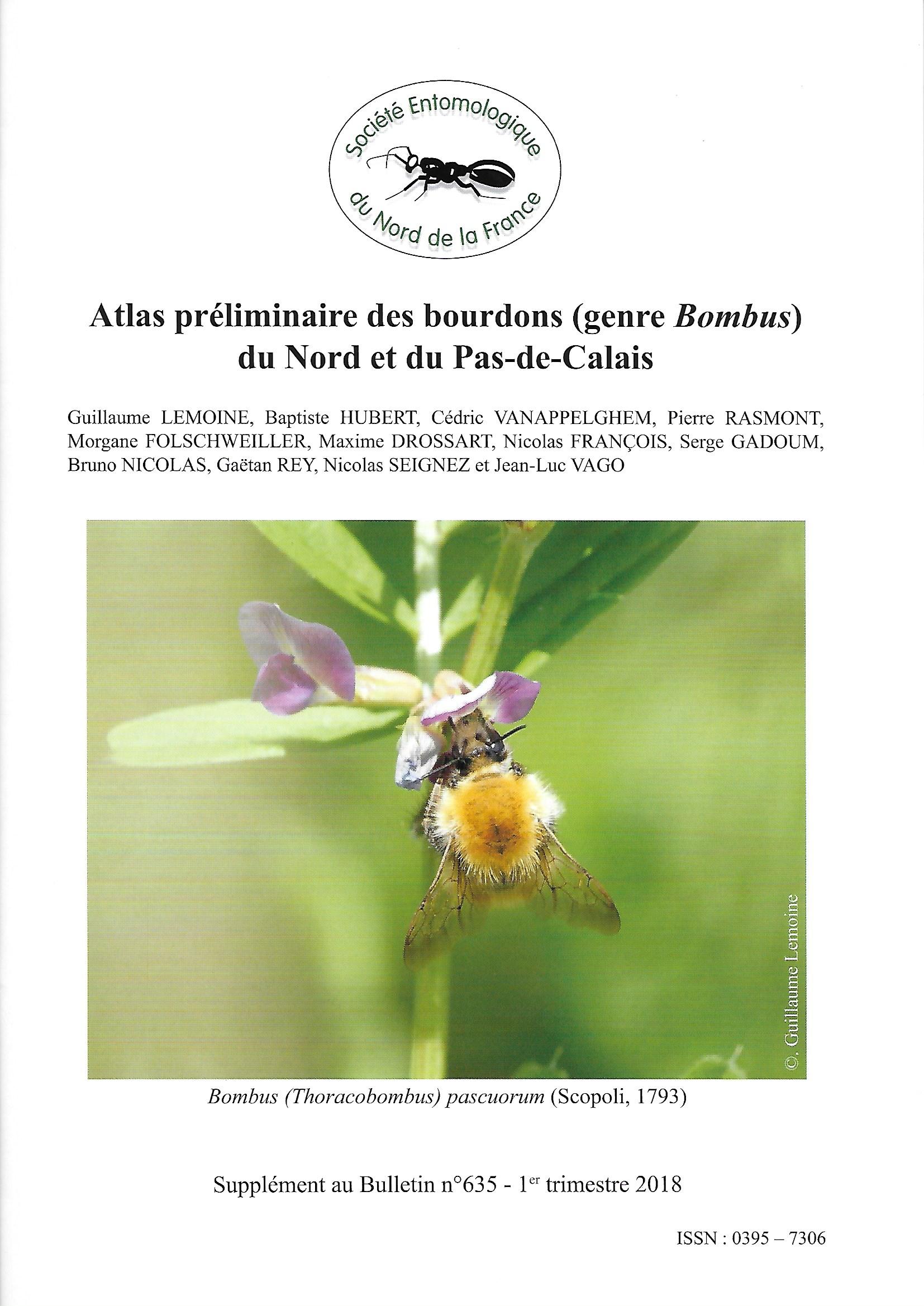
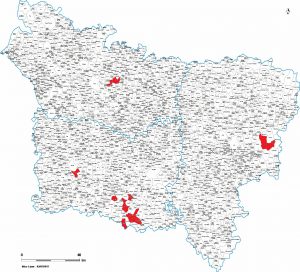








 Gyne (à droite) et ouvrières Myrmica. Photo : L.C.
Gyne (à droite) et ouvrières Myrmica. Photo : L.C.
 Maculinea rebeli (Photo : T. Gérard)
Maculinea rebeli (Photo : T. Gérard) Maculinea arion (Photo : T. Gérard)
Maculinea arion (Photo : T. Gérard) Maculinea arion (Photo : T. Gérard)
Maculinea arion (Photo : T. Gérard)





